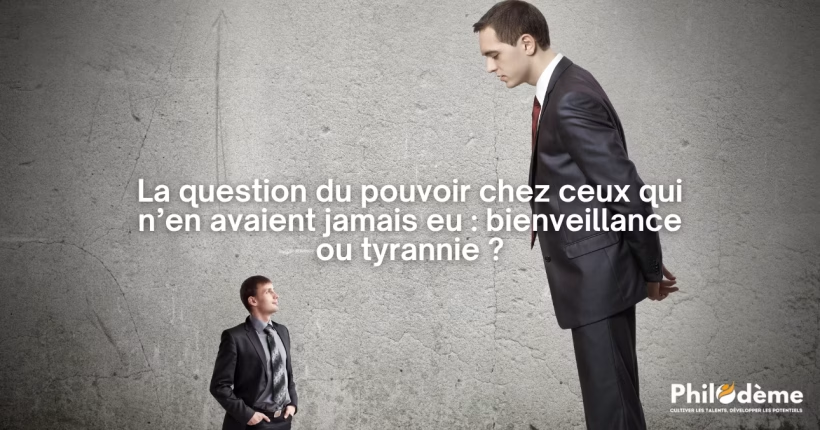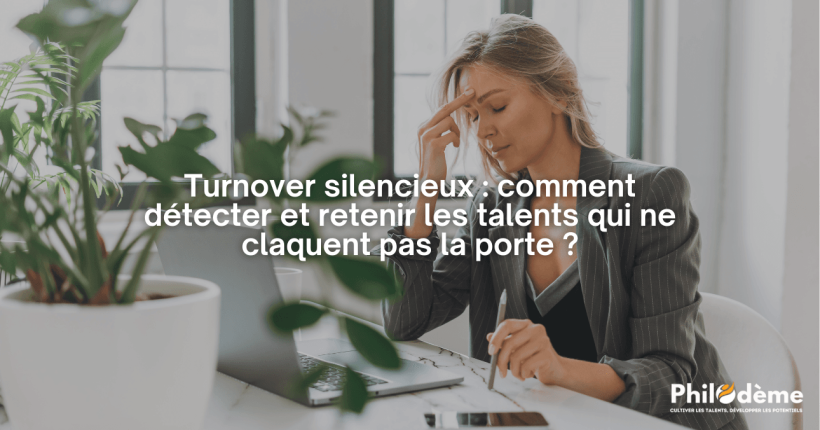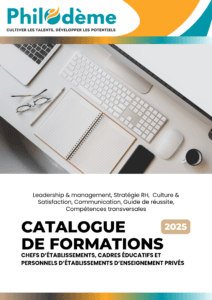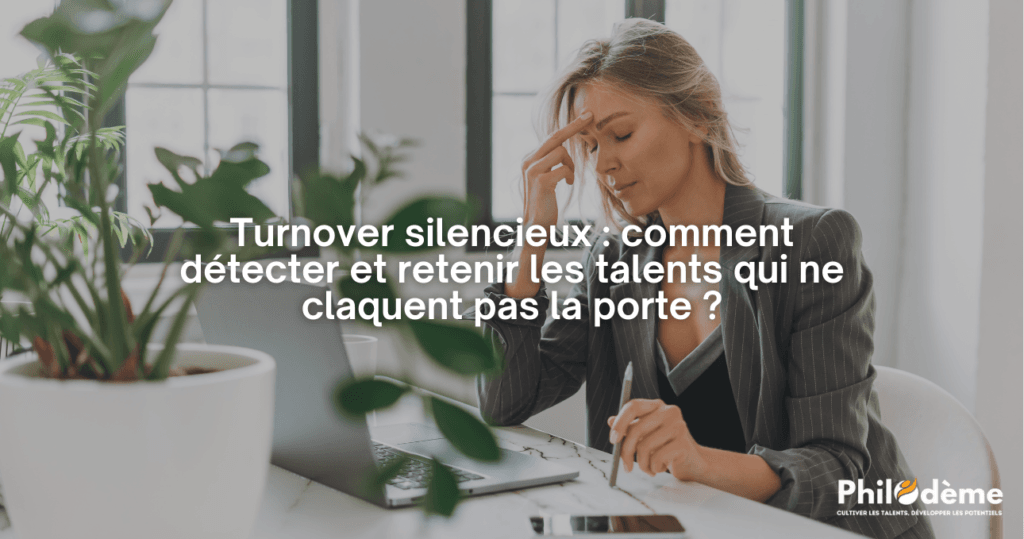La fatigue d’être soi : quand le développement personnel devient une injonction

« Sois toi-même. » Rarement une phrase aura été autant reprise, autant vendue. Elle se veut libératrice, mais elle enferme. Elle promet l’authenticité, mais elle exige la performance. Alors que l’individualité est aujourd’hui brandie comme un totem, l’injonction à être soi vire insidieusement à l’épuisement. Car il ne suffit plus d’être, il faut être la meilleure version de soi-même. Plus performant, plus adapté, plus rayonnant. Et surtout, responsable de tout. Y compris de ses failles.
Alors, on se perfectionne. On s’autoanalyse. On lit des ouvrages de développement personnel en espérant trouver des clés. Mais à force de chercher à mieux être, on finit par ne plus savoir simplement être. Et si cette fatigue moderne, cette lassitude – discrète mais persistante – était le symptôme d’une société qui nous pousse à l’introspection jusqu’à l’épuisement ?
Le culte de la performance de soi
Alain Ehrenberg, sociologue, l’a formulé avec justesse : nous sommes passés d’une société de l’interdit à une société de l’initiative. Là où hier les normes dictaient ce qu’il fallait réprimer, aujourd’hui elles nous somment d’être entreprenants, positifs, responsables de nous-mêmes. L’idéal de liberté s’est retourné contre nous : ce n’est plus la société qui oppresse, c’est l’individu qui se doit tout à lui-même.
Ce basculement a transformé l’idéal d’émancipation en devoir d’amélioration constante. On ne cherche plus à se connaître, mais à s’optimiser. Il ne s’agit plus de vivre avec soi mais de se dépasser. Coûte que coûte. Comme si le moi était un capital à faire fructifier, une entreprise à rentabiliser.
Dans cette logique, l’échec devient une faute. Si l’on souffre, c’est qu’on n’a pas assez bien géré ses émotions, pas assez investi dans son mindset. L’individualité devient une responsabilité totale. Et cette responsabilité pèse. Cette société de la responsabilisation individuelle a pour effet collatéral de renforcer les inégalités sociales : à chacun de se débrouiller, à chacun de se « sauver ».
Le business du bonheur
Le marché du bien-être pèse des milliards. Cours en ligne, applis de méditation, coachs en tous genres, , citations inspirantes sur fond pastel : tout est conçu pour nous faire croire que le bonheur est une question d’optimisation. Pourtant, derrière ces promesses se cache une réalité moins glorieuse.
Le piège ? Transformer l’épanouissement en performance. « Fais du yoga« , « Sois plus productif« , « Pense positif » : ces conseils, en apparence bienveillants, créent une pression sourde. Quand on n’y arrive pas, la faute semble reposer uniquement sur nos épaules. Comme le souligne la sociologue Eva Illouz : « Le développement personnel a détourné les luttes collectives en problèmes individuels à résoudre.«
Certains ouvrages comme Les quatre accords toltèques ou Miracle Morning ont nourri des millions de lecteurs. Mais s’ils peuvent, pour certains, ouvrir des pistes, ils véhiculent aussi des idées dangereuses : le bonheur ne dépend que de soi. Le malheur est une erreur de stratégie. Il suffirait de penser autrement pour vivre autrement.
Cette pensée magique culpabilise les plus fragiles. Elle nie le rôle du social, de l’histoire personnelle, des inégalités structurelles. Elle fait de la souffrance une faiblesse individuelle plutôt qu’un indicateur collectif. Elle transforme la psychologie en outil de conformisme social : pas pour questionner le monde, mais pour mieux s’y adapter.
Eva Illouz parle de « marchandisation des émotions » : nos affects deviennent des produits, nos humeurs un marché, nos quêtes intérieures un levier commercial. Le bonheur, vendu comme une compétence, finit par ressembler à une norme implicite. Être heureux devient une obligation silencieuse.
L’épuisement du moi
La quête de soi devient une âpre compétition. Sur les réseaux sociaux, chacun expose son cheminement, ses routines matinales, ses victoires intérieures. L’intimité devient un terrain de jeu public. On se compare jusque dans ses blessures. Même les échecs sont esthétisés, transformés en tremplins, mis en scène dans une dialectique du rebond obligatoire.
Là où l’on pourrait trouver du soutien, on ne trouve parfois qu’une pression supplémentaire : celle d’être un bon malade, un dépressif lumineux, un anxieux productif. Une souffrance acceptable est une souffrance utile. Là réside peut-être l’un des nœuds de notre modernité : la souffrance n’a plus droit d’être silencieuse, inexploitée, improductive.
C’est là le paradoxe : à force de vouloir s’élever, on s’épuise.
Le développement personnel dérape quand il devient un devoir. Quand il n’est plus un chemin mais une performance. Byung-Chul Han parle de « violence neuronale » : une autoviolence douce, internalisée, qui fait de chacun son propre bourreau.
Et si ne pas aller bien était une forme de lucidité ?
Face à cette pression, une contre-culture émerge. Des mouvements comme le slow living, la self-compassion ou encore la décroissance personnelle proposent une alternative radicale : le droit à l’imperfection, le droit à la pause, le droit à l’ennui.
Il ne s’agit pas de rejeter en bloc toute quête de soi. Mais de refuser l’injonction à l’amélioration permanente. La tristesse, l’ennui, l’errance font partie de l’existence. Les nier, c’est se couper d’une partie de soi.
Ralentir, ne pas savoir, douter : voilà des actes de résistance dans un monde qui nous presse d’être efficaces, alignés, inspirants. Le droit au flou, au temps long, au non-résultat, devient politique.
Comme le disait Arendt, c’est dans la pensée que réside la liberté.
Et penser, parfois, c’est accepter de ne pas avancer. De rester en suspens. De se défaire des réponses prêt-à-porter. Penser, c’est résister à l’évidence. Et ne pas aller bien, c’est parfois l’ultime preuve qu’on ne se laisse pas absorber.
Réapprendre à exister, sans se mesurer
Le développement personnel m’a appris une chose : la croissance ne doit pas être une prison. Parfois, le progrès le plus radical, c’est de s’arrêter. De respirer. D’accepter que, certains jours, être simplement soi – avec ses forces et ses failles – est déjà assez.
Et si dernièrement, vous vous êtes senti coupable de ne pas être « aligné », de ne pas cocher toutes les cases de l’épanouissement personnel, alors peut-être est-il temps de lâcher prise.
Autorisez-vous à ne pas aller bien. À être brouillon, fatigué, silencieux. Offrez-vous le droit de ne rien optimiser. Accordez-vous des pauses sans objectifs. Fuyez les to-do lists intérieures. Reposez-vous, vraiment. Pas pour être plus performants demain. Mais pour simplement être, ici et maintenant.
C’est parfois dans ce désengagement que réside notre plus grande forme de sagesse.
Et si vous avez envie de mieux comprendre tout ça, voici une bibliographie qui saura vous déculpabiliser !
- Alain Ehrenberg, La Fatigue d’être soi : Dépression et société, Odile Jacob, 1998.
- Eva Illouz, Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, Premier Parallèle, 2018.
- Byung-Chul Han, La société de la fatigue, Éditions Circé, 2014.
- Jean-François Dortier, Le cerveau et la pensée, la révolution des sciences cognitives, (2e éd. 2004)
- Christophe Dejours, Souffrance en France, Seuil, 1998.
- Hannah Arendt, La vie de l’esprit, PUF, 1978.
Daphné Derkaoui
Vous aimerez peut-être
-
13 Juin 2025
-
5 Juin 2025
-
11 Fév 2025
-
28 Jan 2025