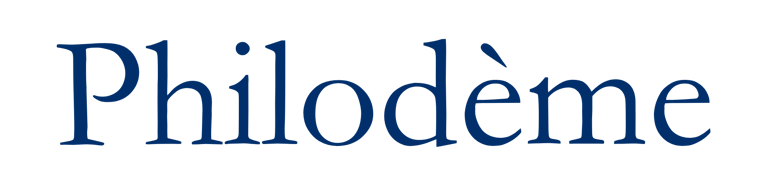Une maison, un écosystème — Pour votre conformité, retrouvez notre engagement sur PhiloPartners.fr · Pour faire grandir ceux qui nous élèvent, découvrez PhiloEdu.fr.
Le mythe de la méritocratie : entre idéal républicain et réalité sociale
Philodème explore les failles de la méritocratie : école, reproduction sociale, inégalités. Un regard critique sur l’idéal républicain et ses dérives.
SOCIÉTÉ & TRAVAIL
Daphné Derkaoui
6/5/2025
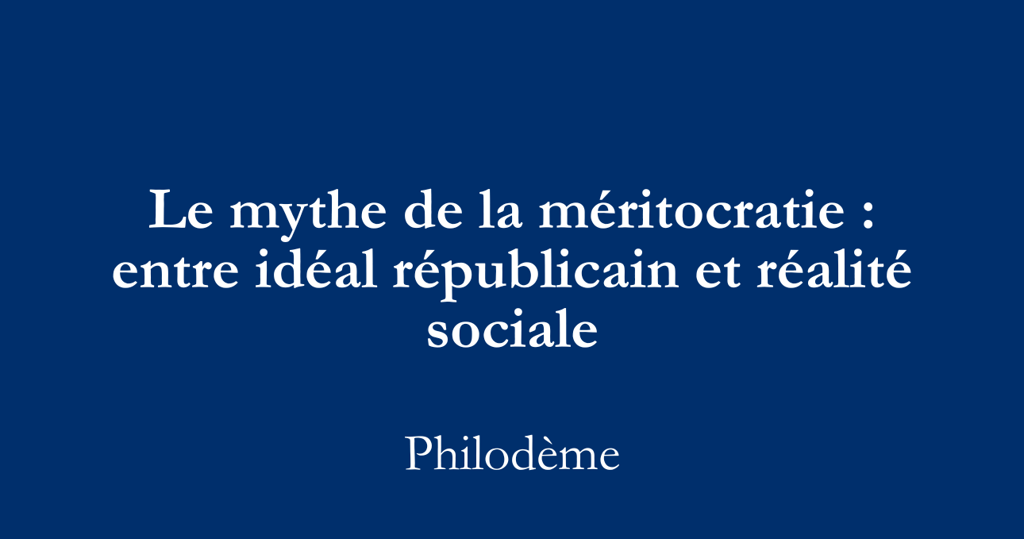
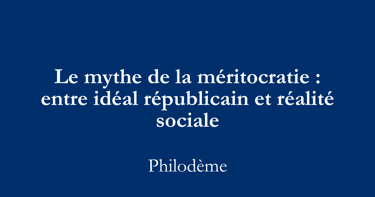
Le mot « mérite » a bonne presse. Il fleure bon l’effort, la récompense juste, le cheminement méthodique vers la réussite. C’est une valeur républicaine, une promesse d’égalité gravée dans le marbre de l’école.
Le saviez-vous ?
Peu le savent, mais le terme “méritocratie” n’a pas été inventé pour en faire l’éloge. Il est né sous la plume acérée du sociologue britannique Michael Young, en 1958, comme une mise en garde.
Dans une fiction satirique, il imaginait une société où les anciennes élites héréditaires laissaient place à une nouvelle aristocratie : celle des diplômés. Une élite qui ne se transmet plus par le sang, mais par les classements, les concours et les titres.
Et il en dénonçait déjà les dérives.
Pourtant, l’actualité nous tend un miroir grinçant : aux États-Unis, l’idéal méritocratique s’effondre sous le poids de ses propres contradictions. Trump, accusé de multiples dérives judiciaires, reste un héros pour des millions d’électeurs. Elon Musk, figure de la réussite entrepreneuriale, multiplie les dérapages en ligne tout en consolidant son pouvoir.
Qu’ont-ils mérité, exactement ? Leur fortune ? Leur audience ? Leur impunité ?
Ces figures ne sont pas des accidents. Elles révèlent un malaise profond : quand on sait qu’aujourd’hui, le capital social et financier se transmet plus qu’il ne se conquiert, que vaut encore le discours du mérite ?
En France aussi, l’école promet, l’école trie. La méritocratie s’affiche en banderole, mais la reproduction sociale fait la réalité du terrain. Les « meilleurs » ne sont souvent que les mieux outillés.
Alors, l’école peut-elle vraiment être un ascenseur social ? Le mérite est-il neutre ? Et si, au fond, la réussite était le masque le plus sophistiqué de l’inégalité ?
Cet article explore les failles du modèle méritocratique à travers le prisme de la sociologie, de l’histoire scolaire et des réalités sociales contemporaines.
Une promesse gravée dans l’école républicaine
Dès la Troisième République, l’école a été pensée comme outil de l’émancipation individuelle. « L’école gratuite, laïque et obligatoire » devait permettre à chacun de gravir les échelons du savoir et donc de la société. En détournant le proverbe : que l’on naisse dans une ferme ou dans un salon, on aurait droit à la même chance, le mérite républicain se voulait l’antidote à la naissance.
Sur le papier, c’est une belle idée. Les concours, les examens, les notes — autant d’outils supposés objectifs pour détecter les talents. L’école est une machine à repérer les méritants et à les récompenser. Ceux qui travaillent dur, qui se montrent assidus, curieux, disciplinés, sont promis à une place au soleil.
On les appelle parfois les « premiers de cordée ». Une métaphore récemment remise aux goûts politiques du jour, mais qui sous-entend que si la cordée est en difficulté, c’est que les derniers n’ont pas su suivre. Et si les premiers tombent, c’est toute la montagne qui s’effondre. Cette vision repose sur une construction presque morale de la réussite : il faudrait mériter d’être en haut et si l’on échoue, c’est que l’on n’avait pas ce qu’il fallait.
Mais la mécanique a ses failles. Car les critères du mérite ne tombent pas du ciel.
Ils sont culturellement construits, historiquement datés, socialement orientés. On ne juge pas tous les élèves avec la même toise, même si l’on prétend le contraire.
Derrière chaque « bon élève », il y a souvent un environnement favorable, une maîtrise implicite des codes, une aisance avec la langue scolaire, le silence, l’écrit, l’abstraction. Autant de compétences invisibles à l’œil nu, mais décisives dans la course au diplôme.
L’école républicaine valorise une forme très spécifique d’intelligence : linéaire, rationnelle, conforme. Et ceux qui ne s’y reconnaissent pas sont souvent perçus comme manquant d’effort. Le mythe du mérite fonctionne alors comme une épuration symbolique : il blanchit l’inégalité en la transformant en choix individuel ou en défaut de volonté.
La promesse d’égalité des chances, loin de réparer les injustices, les rend invisibles.
Le mérite, une invention des dominants ?
« Quand le mérite est défini par ceux qui ont déjà réussi », il ne s’agit plus d’une juste récompense, mais d’une validation de soi par soi-même. Cette phrase, qui pourrait passer pour une provocation, résume pourtant une réalité sociologique largement documentée.
Les biais sociaux derrière l’évaluation scolaire sont nombreux, et souvent invisibles. L’élève évalué n’est jamais un pur esprit. Il est incarné, socialement situé, influencé par son langage, son accent, son comportement, ses références culturelles.
L’institution prétend juger des compétences ; elle juge aussi, malgré elle ou parfois à travers elle, des conformités.
Prenons un exemple : l’épreuve du commentaire littéraire que l’on demande d’exécuter avec soin aux prétendants au Bac de Français. Elle exige non seulement une maîtrise de la langue, mais une capacité à formuler une pensée abstraite d’interprétation juste, argumentée, le tout dans un format codifié. Cette compétence n’est pas universelle. Elle est apprise, transmise, souvent valorisée dans les milieux où la parole est pensée comme légitime. Ceux qui ne parlent pas la « bonne langue » sont souvent notés, inconsciemment, comme moins méritants. Là où de nombreux adultes seraient incapables d’obtenir le graal de la bonne note, on attend des ados qu’ils puissent exceller.
Ce biais, parce qu’il est implicite, est difficile à corriger. Il agit en profondeur dans les mécanismes de sélection. Il naturalise ce qui est en réalité un avantage social. Et il permet au système de se présenter comme équitable, tout en reconduisant les hiérarchies sociales.
Pierre Bourdieu répondait sans ambages : ce sont les dominants. Ceux qui possèdent les capitaux (culturel, économique, social) fixent les critères de reconnaissance.
L’école, loin d’être un espace neutre, agit comme un puissant dispositif de légitimation des hiérarchies sociales.
Le plus ironique, c’est que les enfants des classes supérieures intègrent très tôt les attentes de l’institution scolaire. Leur manière de parler, de se tenir, d’argumenter, d’interroger même, s’accorde naturellement aux codes implicites de l’école. Ils performent sans en avoir l’air. Mieux : on appelle cela du talent.
Mais ce « talent » n’est pas inné. Il est hérité. Transmis. Édulcoré par des siècles d’habitus cultivés. Et dans ce jeu pipé, les autres sont condamnés à l’écart. Ils devront fournir deux, trois, parfois dix fois plus d’efforts pour atteindre le même niveau de reconnaissance.
Ce décalage entre l’effort réel fourni et la récompense obtenue est écrasant. Et là encore, on convoque le mérite pour masquer la structure. On valorise les « exceptions » — ces boursiers brillants, ces self-made élèves — pour faire oublier les centaines d’autres écartés en silence.
Comme si une poignée de trajectoires individuelles suffisaient à démontrer que tout est possible, et donc que l’échec ne peut être que personnel.
De l’ascenseur social… à l’escalier mécanique
Pendant longtemps, l’école a été perçue comme le véhicule idéal de la mobilité sociale. Mais cet ascenseur semble en panne. Pire : il fonctionne de manière sélective, en embarquant toujours les mêmes, et en laissant les autres coincés à l’entrée.
Le sociologue Camille Peugny l’a montré : les enfants d’ouvriers ont aujourd’hui moins de chances d’intégrer les grandes écoles qu’il y a quarante ans. La massification scolaire n’a pas tenu sa promesse. Elle a certes permis d’augmenter le nombre de diplômés, mais sans réduire les inégalités de parcours.
Julien Damon parle d’un escalier mécanique : les uns montent tranquillement, portés par leur capital familial, pendant que d’autres s’essoufflent à gravir les marches à pied. Certains, même, sont bloqués sur le palier de départ. Ce n’est pas que l’école empêche de monter. C’est qu’elle facilite le trajet de ceux qui sont déjà en haut.
Et pendant ce temps, on continue à faire croire à tous que le mérite suffit. Qu’il suffit de travailler, de croire en soi, de persévérer. Ce discours, pourtant bien intentionné, devient une violence symbolique. Il nie les obstacles systémiques, invisibilise les déterminismes, isole ceux qui luttent sans réussir.
L’école, en créant une illusion d’équité, participe ainsi à la légitimation des inégalités. Elle ne réduit pas les écarts : elle les habille d’un vocabulaire de mérite et de responsabilité individuelle.
Et si la réussite était un masque ?
La réussite est présentée comme l’aboutissement ultime du mérite. Mais une question dérange : réussir selon quels critères ? Pour être reconnu par qui ? Et surtout, à quel prix ?
Pour beaucoup, notamment ceux issus des milieux populaires ou des minorités sociales, réussir signifie s’adapter. Se conformer. Adopter les codes d’un monde qui ne leur ressemble pas. Parler la bonne langue, porter les bons vêtements, adopter les bons comportements. Derrière la reconnaissance se cache parfois une dépossession : celle de soi-même, de son histoire, de ses origines.
Réussir devient alors une stratégie de survie. Une manière de s’acheter une légitimité dans un monde qui ne vous a pas attendu. Le mérite, dans ce contexte, n’est pas libérateur. Il est un passeport conditionnel, un camouflage nécessaire pour passer la douane sociale.
Les boursiers d’excellence, les transfuges de classe, les “miraculés” de l’école républicaine racontent souvent un même malaise : celui de n’être à l’aise nulle part. Trop éloignés de leur milieu d’origine pour s’y sentir encore pleinement légitimes, mais jamais totalement acceptés par ceux dont ils ont rejoint les rangs.
Ils vivent avec le poids du syndrome de l’imposteur, avec la peur d’être démasqués. Et souvent, dans leur parcours, ils n’osent pas évoquer leurs difficultés, par peur de ne plus mériter ce qu’ils ont acquis.
Le mérite devient un piège : il oblige à cacher la fatigue, à minimiser les fractures, à sourire quand on vacille.
Dans cette logique, on ne s’arrête jamais. Chaque réussite appelle une autre. Chaque reconnaissance doit être renouvelée. Il ne suffit pas d’avoir réussi : il faut continuer de prouver qu’on le mérite.
Cette quête perpétuelle d’auto-légitimation est éreintante. Elle enferme dans une course sans fin. Et elle empêche toute critique du système, puisqu’on est censé en être la preuve vivante qu’il fonctionne.
Mais si la réussite n’était qu’un masque ? Un masque poli, socialement valorisé, mais fragile. Un masque qui dissimule la violence symbolique qu’il faut parfois traverser pour “réussir comme il faut”.
Faut-il déconstruire le mérite ?
Déconstruire le mérite ne signifie pas nier l’effort ou la réussite. Cela signifie questionner ce que la société récompense, et pourquoi. Cela signifie sortir du mythe de la neutralité pour regarder, enfin, les inégalités dans les yeux.
Il ne s’agit pas de mépriser les parcours de réussite, mais de comprendre qu’ils sont rarement le fruit d’un effort pur, isolé, héroïque. Et qu’ils ne devraient jamais servir à justifier l’échec des autres.
Il est temps de sortir d’une logique élitiste, de cette obsession pour les “exemples” qui cachent des silences plus nombreux que les applaudissements. Il faut apprendre à valoriser les parcours modestes, cabossés, en zigzag. Ceux qui avancent lentement. Ceux qui chutent, se relèvent, hésitent.
La société du mérite est une société qui trie. Une société de la reconnaissance, en revanche, serait une société qui écoute. Qui comprend que la valeur d’un être humain ne se mesure ni à ses diplômes, ni à ses revenus, ni à sa capacité à “grimper”. Mais à sa capacité à exister — dignement, librement, quel que soit son point de départ.
Bibliographie
Ouvrages de référence
Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Éditions de Minuit, 1964.
➤ Analyse fondatrice sur la reproduction sociale par l’école.
Pierre Bourdieu, La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Éditions de Minuit, 1970.
➤ Théorisation du rôle de l’école dans la légitimation des hiérarchies sociales.
Camille Peugny, Le Déclassement, Grasset, 2009.
➤ Sur la panne de mobilité sociale et la promesse non tenue de l’école.
Julien Damon, Les classes moyennes à la dérive, Presses Universitaires de France, 2013.
➤ Métaphore de l’escalier mécanique pour décrire la dynamique sociale française.
François Dubet, Les places et les chances, Seuil, 2010.
➤ Différence entre une société des places (hiérarchique) et des chances (égalitaire).
Jean-Paul Delahaye, L’école n’est pas faite pour les pauvres, Seuil, 2019.
➤ Témoignage fort sur les inégalités scolaires vécues au quotidien.
Études et articles complémentaires
INSEE, France, portrait social 2024, chapitre sur la mobilité sociale.
➤ Données statistiques sur les trajectoires scolaires et sociales.
Observatoire des inégalités, Les inégalités d’accès aux grandes écoles, rapport 2024.
➤ Analyse quantitative sur les biais d’origine sociale dans les filières d’élite.
CNESCO, Plénière 1 : La mesure des mixités sociales à l’école : une problématique statistique mais aussi politique et éthique, juin 2015
➤ Étude sur les effets des politiques publiques sur les inégalités scolaires.
Pour aller plus loin (podcasts et vidéos)
Le Cours de l’Histoire, France Culture : Renouvellement des élites : la pensée visionnaire de Michael Young
Webconférence | Inégalités et mobilité sociale en France : quel diagnostic ? avec Camille Peugny : YouTube
Philodème
Tenir ses promesses
© 2025. Tous droits réservés
On comprend vraiment Philodème en franchissant ses portes.
Dirigeants, rencontrons-nous. Vous repartirez avec du vrai.
Maison de conseil en Ressources Humaines