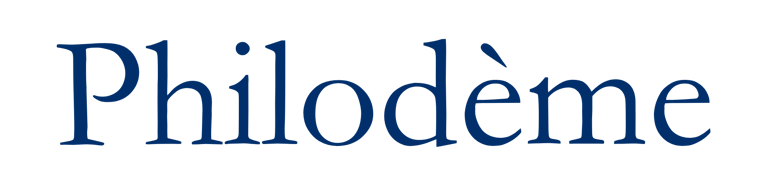Une maison, un écosystème — Pour votre conformité, retrouvez notre engagement sur PhiloPartners.fr · Pour faire grandir ceux qui nous élèvent, découvrez PhiloEdu.fr.
Repenser la formation, le formateur comme guide des échanges
Pourquoi la discussion entre pairs décuple l’apprentissage. Rôle du formateur, cadre, moments clés et synthèse : une pédagogie des échanges, exigeante et efficace.
PÉDAGOGIE & APPRENTISSAGE
Pierre-François Oliveros
5/31/2025
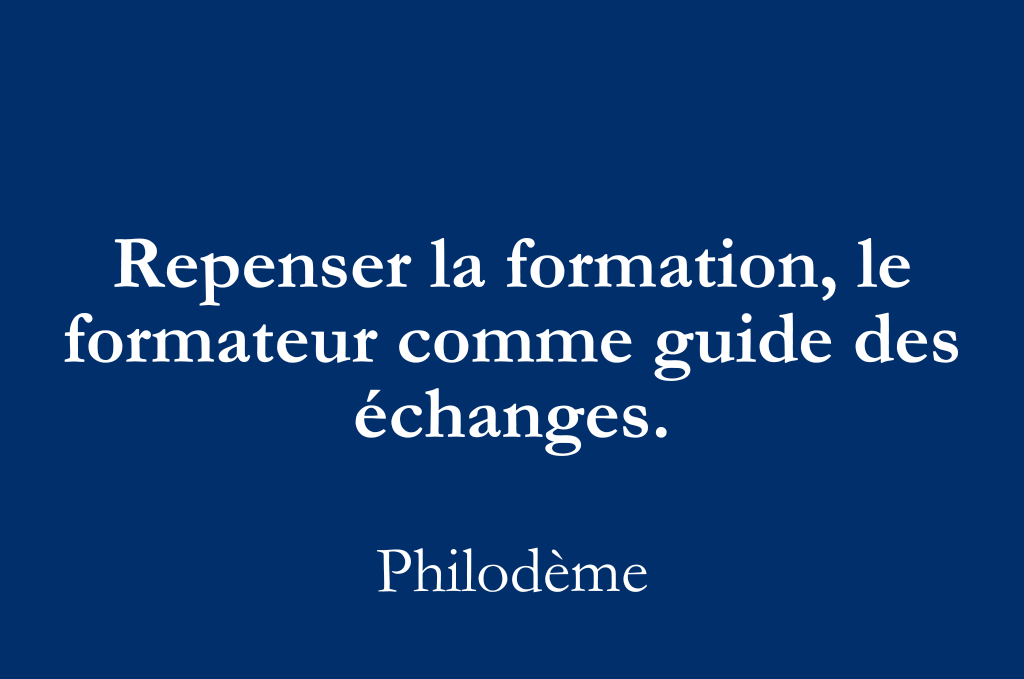
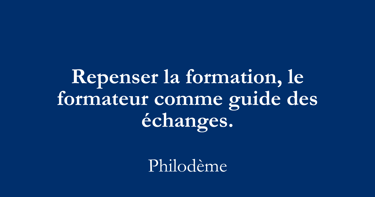
L’efficacité des méthodes d’apprentissage est aujourd’hui un sujet de débat constant. Les avancées en neurosciences nous éclairent sur le fonctionnement de notre cerveau : comment il traite, analyse et intègre l’information. Or, une formation ne peut être considérée comme réussie que si l’apprenant parvient à s’approprier réellement les connaissances et à les mobiliser efficacement dans sa pratique.
Dès lors, quelle méthode d’apprentissage l’intervenant doit-il exploiter pour favoriser cette assimilation ?
Une chose est désormais bien établie : un cours magistral où les informations s’enchaînent sans interruption n’est pas adapté au fonctionnement cognitif humain. On sait aujourd’hui que l’implication active de l’apprenant est un élément central dans son apprentissage. C’est en étant acteur de sa formation qu’il apprend le mieux. D’où la nécessité de multiplier les activités et évaluations formatives, qui lui permettent de mettre immédiatement en pratique ce qu’il a appris et de s’autoévaluer pour mieux l’intégrer.
Toutefois, un autre levier mérite d’être exploré : l’échange naturel entre les apprenants. Lors d’une formation, on observe souvent des discussions spontanées entre participants, où chacun partage ses expériences, ses difficultés et ses solutions. Ces échanges, bien qu’informels, sont parfois plus enrichissants que la formation elle-même, tant ils permettent aux apprenants de confronter leurs idées et de les adapter à leur réalité. Par exemple, lors d’une formation sur la rédaction professionnelle de mails, les apprenants, en discutant, ont réalisé que leur difficulté n’était pas tant d’écrire que de gérer la relation client dans leurs échanges professionnels. Ce sont ces discussions qui ont révélé leur véritable besoin.
Ces moments de discussion ne sont pas qu’un simple échange d’opinions : ils sont un véritable moteur d’apprentissage collectif. Ils favorisent la prise de recul, l’émergence de solutions concrètes et une cohésion de groupe qui améliore l’engagement des participants. Pourtant, ces discussions restent souvent sous-exploitées en formation, justement parce qu’elles se déroulent de manière informelle. N’étant pas intégrées dans un cadre pédagogique structuré, elles passent inaperçues et ne sont pas reconnues à leur juste valeur comme un levier d’apprentissage.
Dès lors, une question se pose : comment enrichir l’expérience de la formation en favorisant la discussion entre apprenants ? Nous verrons pourquoi ces échanges sont si bénéfiques, comment le formateur peut les stimuler et de quelle manière les structurer pour en tirer le meilleur parti.
Pourquoi les échanges entre apprenants sont bénéfiques
Les échanges révèlent les véritables besoins des apprenants
Proposer une formation à un groupe d’apprenants, que ce soit au sein d’une entreprise ou non, c’est chercher à leur permettre de développer leurs compétences. Pour ce faire, il est primordial, pour des raisons pédagogiques, voire obligatoire dans le cadre de la certification Qualiopi, de réaliser en amont un questionnaire. Celui-ci a pour objectif d’identifier les besoins et attentes des apprenants afin de concevoir un contenu et des activités adaptés. C’est un outil clé pour le formateur, mais il présente aussi certaines limites.
En effet, il ne met en lumière que les besoins conscients des apprenants, ceux qu’ils peuvent exprimer spontanément en remplissant le questionnaire. Or, les réelles difficultés sont souvent difficiles à formuler ou bien occultées par d’autres préoccupations secondaires.
De plus, le questionnaire peut être perçu comme une simple formalité administrative et être rempli de manière incomplète ou superficielle. Certains y répondent brièvement, d’autres peinent à mettre des mots sur leurs attentes. Cela peut compromettre la pertinence de la formation, qui risque alors de ne répondre qu’aux besoins déclarés et non aux besoins réels.
C’est ici que la discussion en formation prend tout son sens. Contrairement au questionnaire, elle ne repose pas sur une réflexion individuelle, mais sur un échange collectif.
Chacun réagit, complète et nuance les propos des autres, ce qui permet de faire émerger des problématiques plus profondes, plus précises et souvent insoupçonnées.
Si les apprenants s’installent autour d’une table face à un formateur, c’est avant tout parce qu’ils cherchent à développer une compétence essentielle à leur métier. Ils s’attendent naturellement à recevoir un enseignement structuré, conçu pour répondre à leurs besoins. Une formation bien pensée leur apportera des connaissances utiles qu’ils pourront appliquer rapidement.
Lors d’une activité, les apprenants se regroupent en petits comités et suivent les consignes avec enthousiasme. Une fois l’exercice terminé, ils sont invités à présenter leurs travaux, puis à échanger leurs impressions sur l’expérience. Très vite, la discussion s’anime : chacun donne son avis, réagit aux propos des autres, remet parfois en question certains points. Et soudain, au fil des échanges, un apprenant met le doigt sur un point essentiel. Ce qu’il recherchait vraiment dans cette formation, la raison même qui l’a poussé à s’y inscrire, il n’avait jamais réussi à le formuler clairement dans le questionnaire initial. Mais en l’exprimant à voix haute, il réalise que son problème est partagé par tous.
L’échange a joué le rôle de catalyseur : en confrontant leurs expériences, les apprenants ont clarifié leur besoin réel et l’ont transformé en un problème concret à résoudre. Les plus expérimentés ont proposé une solution, aussitôt enrichie par la vision d’un apprenant plus jeune, qui a apporté un regard neuf. Chacun a pu affiner sa compréhension, réajuster ses pratiques et élaborer une réponse adaptée à la réalité du terrain.
Finalement, c’est bien l’échange qui a permis de lever cette difficulté. Aussi compétent soit-il, le formateur n’aurait jamais pu identifier seul cette problématique : il ne vit pas leur quotidien, ne partage pas leurs habitudes de travail. Et pourtant, c’est cette prise de conscience qui a transformé leur perception du problème. Non seulement la formation leur a apporté des outils, mais elle leur a aussi permis de mettre en lumière un besoin profond qu’ils n’avaient pas su formuler eux-mêmes.
La discussion améliore l’apprentissage
Un autre atout majeur de cette approche réside dans son impact sur l’engagement des apprenants. Le cerveau collectif qui s’est formé au fil des échanges n’a pas seulement permis de résoudre des problèmes concrets : il a aussi renforcé l’implication du groupe. En partageant leurs expériences et en réagissant aux idées des autres, les participants se sont sentis écoutés et valorisés. Cette dynamique a encouragé une participation toujours plus active, créant un cercle vertueux où l’échange alimente l’engagement et inversement.
La motivation des apprenants est un indicateur clé de la réussite d’une formation et un enjeu majeur pour tout formateur. Or, nous avons observé un véritable tournant dès lors que la discussion s’est invitée dans l’échange. Bien que les participants aient été impliqués depuis le début, cet instant a marqué l’apogée de la formation, révélant une motivation plus intense que jamais.
Toute trace de passivité avait disparu : les échanges s’animaient, l’énergie du groupe montait en intensité, et chacun prenait pleinement conscience de sa progression. En discutant activement et en confrontant leurs idées, les apprenants ont perçu de manière tangible l’utilité de leurs apprentissages. Ainsi, cette dynamique a renforcé leur implication et leur appropriation des compétences abordées.
L’impact de l’échange sur la motivation est indéniable. Lorsque les apprenants constatent que leurs interventions font avancer la discussion et apportent une réelle valeur au groupe, ils gagnent en assurance et en engagement. On l’a vu plus tôt : un simple partage d’expérience peut parfois révéler un besoin profond jusque-là insoupçonné. Ce type de prise de parole déclenche un effet d’entraînement où chacun, en contribuant, encourage les autres à faire de même. Loin d’être un simple échange, la discussion devient un levier puissant qui propulse l’apprentissage et nourrit durablement la motivation collective.
Pour conclure, il est essentiel de souligner l’impact de cette méthode sur la mémoire des apprenants. Une formation engageante ne se contente pas de stimuler la motivation et le dynamisme du groupe : elle facilite également la mémorisation, permettant aux participants d’intégrer durablement les compétences travaillées.
En prenant du plaisir à échanger, en s’impliquant activement et en participant aux réflexions collectives, l’apprenant ancre plus solidement les apprentissages. Cette dynamique renforce l’appropriation des compétences et favorise leur mise en pratique. Plusieurs semaines après la formation, l’effet était visible : dans leurs réponses aux clients, les apprenants appliquaient non seulement les enseignements transmis, mais surtout les éléments qu’ils avaient construits ensemble au fil des discussions.
Au final, ce ne sont pas tant les contenus théoriques qui ont marqué les participants, mais bien les échanges qu’ils ont eus entre eux. Preuve que le dialogue, bien plus que la simple transmission descendante du savoir, est un levier puissant pour un apprentissage durable et ancré dans la pratique.
Faciliter l’échange ou l’encadrer : quel équilibre pour le formateur ?
Créer un cadre propice à l’échange
La gestion des échanges en formation pose un véritable défi au formateur : comment allier un cadre structuré tout en laissant place à la spontanéité des apprenants ?
D’un côté, une structure rigide a l’avantage d’offrir un cadre clair et rassurant. Elle permet au formateur de couvrir efficacement l’ensemble des points prévus et d’optimiser le temps de formation. Mais à trop vouloir encadrer, on risque d’étouffer les échanges, privant ainsi les apprenants d’un levier essentiel à leur apprentissage. La formation pourrait alors ressembler à un cours magistral, où l’implication des participants est réduite, au détriment de leur engagement et de l’assimilation des savoirs.
À l’inverse, une formation où les échanges sont totalement libres présente aussi ses limites. Sans cadre précis, deux risques majeurs apparaissent : une dispersion des discussions qui empêche d’atteindre les objectifs pédagogiques et une perte de repères pour les apprenants, qui ont besoin de moments de stabilisation cognitive pour assimiler efficacement l’information.
Le rôle du formateur est donc d’orchestrer ces échanges de manière stratégique. Plutôt que d’opposer rigidité et liberté, il doit trouver un équilibre en intégrant des moments de discussion structurés dans le cadre de la formation elle-même.
Quand et comment intégrer la discussion ? Une première approche consisterait à organiser la discussion avant l’activité, pour faire émerger les véritables besoins des apprenants. Cette méthode a l’avantage de permettre aux participants d’identifier leurs difficultés avant même d’entrer dans la phase d’apprentissage. Mais elle comporte un risque : si un point clé émerge, le formateur devra potentiellement revoir sa progression et adapter son contenu en temps réel, ce qui peut déséquilibrer l’ensemble de la formation.
Une approche plus efficace consiste à intégrer ces échanges pendant ou après l’activité. Ici, la discussion devient un outil d’approfondissement structuré, où les apprenants confrontent leurs idées après avoir expérimenté concrètement. Cela permet une meilleure assimilation et évite au formateur de devoir improviser en plein milieu de sa session.
C’est précisément ce qui sest produit lors d’une formation sur la rédaction de mails professionnels. Après une activité pratique où les apprenants ont travaillé sur des cas concrets, une discussion a été lancée pour analyser leur travail. C’est à ce moment-là qu’un point inattendu a émergé : leur principale difficulté ne résidait pas tant dans la rédaction des mails en soi, mais dans la gestion de la relation client à travers ces échanges. Le formateur a pu s’appuyer sur cette réflexion pour approfondir cette dimension et ainsi apporter des réponses plus adaptées aux besoins réels des participants.
Cet exemple illustre bien l’intérêt d’intégrer la discussion après l’activité : les apprenants ont d’abord expérimenté, puis ont pris du recul, ce qui leur permet de mieux formuler leurs réflexions et d’identifier des difficultés qu’ils n’avaient pas envisagées au départ.
En définitive, la discussion en formation ne doit ni être un simple à-côté, ni être imposée au détriment du déroulé pédagogique. C’est un outil puissant, à condition qu’il soit intelligemment structuré pour enrichir l’apprentissage sans déstabiliser l’organisation de la formation.
Le formateur comme facilitateur d’échange
Imaginez une rivière. Son courant suit naturellement son cours, contournant les obstacles qui tentent de le stopper. Plus on essaie de l’entraver, plus il trouve un autre chemin, s’accélère et échappe au contrôle. Mais en guidant l’eau avec de légères digues, on peut orienter son flux sans jamais le contraindre. Les échanges en formation fonctionnent de la même manière.
Si le formateur tente de les contenir trop rigidement, ils surgiront ailleurs, parfois hors sujet, voire dans des discussions parallèles. À l’inverse, s’il les accompagne et leur donne une direction subtile, il peut les amener là où ils seront les plus profitables pour l’apprentissage.
Plutôt que de freiner les discussions spontanées, mieux vaut leur offrir un cadre souple, où elles peuvent s’épanouir tout en restant alignées avec les objectifs pédagogiques.
C’est pourquoi il est essentiel de tirer parti de chaque intervention des apprenants. Lorsqu’un participant prend la parole, c’est qu’il perçoit une problématique qui mérite une réponse. Mais cette réponse ne doit pas nécessairement venir du formateur : ce sont les autres apprenants qui, par leurs expériences et leurs points de vue, peuvent l’enrichir et l’affiner. C’est ainsi qu’une discussion commence à émerger. Le rôle du formateur est alors d’assurer que le participant en ressorte avec une réponse pertinente, qui bénéficiera d’ailleurs à l’ensemble du groupe.
Pour ce faire, il ne doit pas adopter une posture magistrale et donner la réponse immédiatement. Au contraire, plus une question est complexe, plus l’échange qui en découle sera riche. Le formateur devient alors un observateur attentif, veillant à ce que la discussion suive une trajectoire constructive. Son rôle n’est pas d’apporter directement la solution, mais d’orienter les échanges en posant les bonnes questions, à l’image de la méthode socratique.
Le questionnement joue ici un double rôle. Il stimule la réflexion : plutôt que de fournir une réponse toute faite, le formateur pose des questions ouvertes, incitant les apprenants à explorer différentes perspectives. Par exemple, face à un problème rencontré par un participant, il peut interroger : « Quelles stratégies avez-vous déjà mises en place pour y répondre ? », « Avez-vous rencontré une situation similaire dans un autre contexte ? » ou encore « Comment expliqueriez-vous ce problème à quelqu'un qui ne le connaît pas ? ».
Il permet également de maintenir le cap : il ne s’agit pas de laisser la discussion dériver sans objectif. À travers des reformulations et des relances ciblées, le formateur recentre le débat lorsque celui-ci s’éloigne du sujet principal. Il peut notamment demander : « En quoi cette idée vous semble-t-elle liée à notre problématique de départ ? » ou « Comment cette solution pourrait-elle être mise en pratique dans votre contexte ? ».
Grâce à cette approche, l’apprentissage devient un processus actif, où les apprenants construisent leurs propres réponses et développent leur esprit critique. Cette approche garantit une discussion à la fois libre et cadrée : elle permet aux apprenants de construire leurs propres solutions tout en s’assurant que le débat reste centré sur l’objectif d’apprentissage, sans se perdre dans des digressions.
Il peut arriver que certains groupes soient plus ou moins réceptifs à la discussion, notamment en fonction de leur cohésion. Dans ce cas, le formateur joue un rôle clé en stimulant et en structurant l’échange afin qu’il soit bénéfique pour tous.
L’un des cas les plus fréquents est celui d’apprenants très investis, voire trop, qui ont tendance à monopoliser la parole. Le formateur devient alors un régulateur et doit veiller à une répartition équilibrée des interventions. Il peut solliciter directement les participants plus en retrait en leur posant des questions ouvertes, comme « Qu’en pensez-vous ? », afin de leur offrir un espace pour s’exprimer. Il peut également instaurer dès le début des règles favorisant un échange équilibré, par exemple en limitant le temps de parole de chacun ou en organisant un tour de table. Ce type de cadre permet d’éviter qu’un ou plusieurs participants ne prennent trop de place au détriment des autres et assure que chacun puisse contribuer à la discussion.
Un autre risque des échanges est l’égarement. Lorsqu’une discussion s’éloigne trop du sujet principal, elle peut brouiller les objectifs de la formation et faire perdre du temps au groupe. Dans cette situation, le formateur doit intervenir avec subtilité en reformulant les propos tenus et en posant des questions permettant de recentrer la discussion. Il peut par exemple résumer une idée et demander au groupe en quoi elle se rattache au sujet initial. Loin d’être une interruption brutale, cette approche guide naturellement les apprenants vers une réflexion constructive et ancrée dans les objectifs d’apprentissage.
À l'inverse, certains groupes peuvent se montrer peu participatifs, notamment en début de formation. La timidité, le manque de confiance ou la peur du jugement freinent parfois les échanges et empêchent les apprenants d’oser prendre la parole. Pour surmonter ces obstacles, le formateur peut commencer par poser des questions ouvertes et accessibles, permettant d’amorcer la discussion en douceur. Il peut également favoriser le travail en petits groupes, ce qui crée un cadre moins intimidant et encourage les participants plus réservés à s’exprimer. Enfin, son attitude joue un rôle essentiel : en adoptant une posture bienveillante et en valorisant chaque intervention, il instaure un climat de confiance où les apprenants se sentent légitimes et encouragés à participer.
Ainsi, le formateur ne se contente pas d’observer passivement les discussions. Il doit les animer, les réguler et les structurer avec finesse afin que chaque apprenant trouve sa place et que l’échange profite à l’ensemble du groupe.
De la discussion à l’action : structurer et ancrer les apprentissages
Toutefois, animer une discussion ne suffit pas : encore faut-il en extraire les apprentissages clés et les inscrire dans une dynamique d’action. C’est ici qu’intervient le travail de synthèse et d’ancrage du formateur.
Bien évidemment, l’échange ne peut s’arrêter sur un simple accord commun sans que rien n’en soit tiré. C’est pourquoi le formateur joue un rôle clé dans la synthèse et la valorisation de la réflexion collective. Il doit reprendre l’ensemble des idées échangées, retracer le cheminement du groupe et en tirer une conclusion qui mettra en lumière les apports de chacun. C’est également à ce moment qu’il clôture la discussion pour assurer la transition vers la suite de la formation.
La synthèse doit être réalisée avec précision, en restant fidèle aux propos des apprenants et en évitant toute interprétation qui pourrait dénaturer leur raisonnement. Il est donc essentiel de rappeler les différentes étapes du raisonnement collectif, l’enchaînement des idées ainsi que les points d’accord et de divergence. Ces derniers sont particulièrement intéressants, car ils permettent de souligner les questionnements clés et de valoriser la richesse des différentes perspectives.
Toutefois, une discussion, aussi pertinente soit-elle, n’a de véritable impact que si elle débouche sur une application concrète. Le formateur doit ainsi rappeler en quoi cet échange s’inscrit dans les objectifs de la formation et comment il enrichit l’apprentissage. Il peut proposer un exercice d’application au sein d’une activité afin que les apprenants puissent tester immédiatement les idées issues de la discussion, en identifier les limites et en explorer les opportunités.
C’est exactement ce qui sest produit lors d’une formation sur la rédaction de mails professionnels. Après un échange animé sur la tonalité et l’impact des formules de politesse, les participants ont immédiatement ajusté leur production. Chacun a intégré à sa manière les apprentissages issus de la discussion : certains ont remplacé un « Cordialement » standardisé par un « Bonne journée », d’autres ont choisi une formule plus personnalisée, comme « En vous souhaitant une belle journée », et l’un deux, travaillant dans le secteur de l’assurance, a opté pour un « Assurément » en clin d’oeil à son domaine. Cet exercice spontané a permis aux apprenants de s’approprier concrètement les recommandations et de les adapter à leur contexte professionnel.
Enfin, pour assurer un ancrage durable, il est essentiel d’encourager les participants à mettre en pratique ces nouvelles connaissances dans leur environnement professionnel ou quotidien.
Conclusion
L’apprentissage ne se limite pas à un simple transfert de savoirs. Si les échanges entre apprenants sont si précieux, c’est parce qu’ils révèlent des besoins profonds, enrichissent l’expérience et favorisent un véritable ancrage des connaissances. Mais pour qu’ils soient pleinement profitables, encore faut-il qu’ils trouvent leur juste place dans la formation.
C’est ici que le rôle du formateur prend toute son importance. Il ne s’agit pas simplement d’ouvrir un espace de discussion, mais de savoir quand et comment l’intégrer. Trouver l’équilibre entre liberté et cadre, orienter sans brider, questionner sans imposer, voilà les défis qu’il doit relever pour transformer ces moments d’échange en véritables leviers pédagogiques.
Ainsi, une formation efficace ne repose pas seulement sur ce qui est enseigné, mais aussi sur ce qui est construit ensemble. Et c’est bien là toute la force du collectif : apprendre à plusieurs, c’est apprendre mieux.
Philodème
Tenir ses promesses
© 2025. Tous droits réservés
On comprend vraiment Philodème en franchissant ses portes.
Dirigeants, rencontrons-nous. Vous repartirez avec du vrai.
Maison de conseil en Ressources Humaines